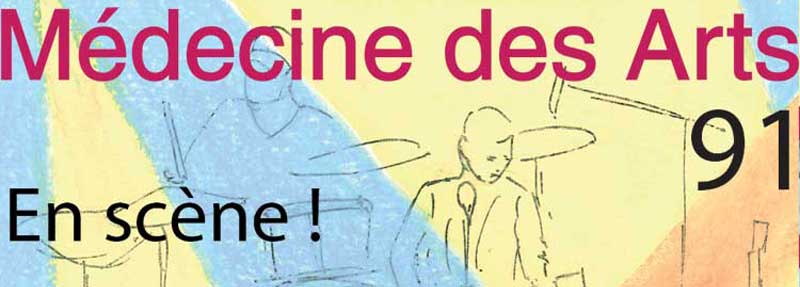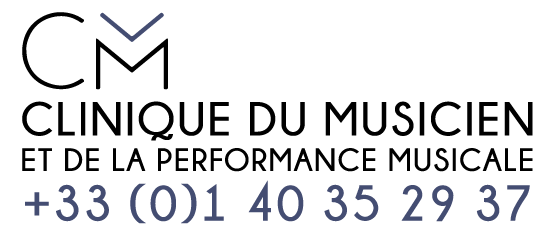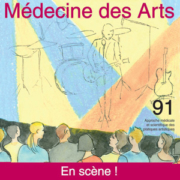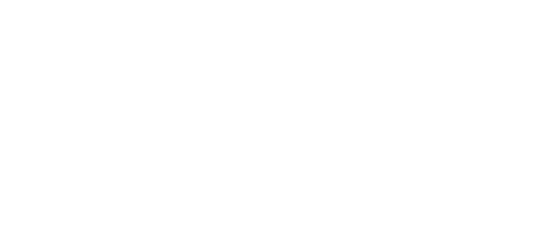Dystonie de fonction de la main droite chez un musicien
Appelé à tord crampe du musicien, voire de crampe de l’écrivain, la dystonie de fonction n’est pas une crampe mais un trouble neurologique focal, c’est-à-dire localisé le plus souvent au niveau du membre supérieur ou au niveau de l’embouchure chez l’instrumentiste à vent.
La dystonie de fonction du musicien affecte 1% des musiciens. Cette affection touche des musiciens de haut niveau, plus volontiers les professionnels ainsi que des amateurs de bon niveau. Les hommes sont plus fréquemment touchés que les femmes, l’âge médian est de 35 ans.
La dystonie de fonction est caractérisée par des contractions musculaires involontaires au niveau de la main ou des muscles de la face selon les pratiques.
Les musiciens se plaignent le plus souvent au début par une difficulté à réaliser un geste technique qu’auparavant il réalisait aisément, une tension, un manque de contrôle de la main ou des doigts, ou des muscles de l’embouchure chez les instrumentistes à vent. Ces troubles ne sont pas douloureux et se révèlent dans certains traits musicaux. La localisation de la dystonie est généralement dépendante de l’instrument de musique pratiqué, le trouble touche plus volontiers les zones anatomiques qui exercent les mouvements les plus rapides, les plus précis, la main droite du pianiste, la main gauche du violoniste, les muscles de l’embouchure chez les instrumentistes à vent. Mais on peut retrouver de manière minoritaire des configurations variées voire les deux mains touchés. Au niveau des mains par exemple, la dystonie se caractérise par un doigt dystonique en flexion avec un ou plusieurs doigts compensateurs en général en extension.
Ces troubles se manifestent uniquement en jouant de l’instrument, les activités quotidiennes ne sont pas touchées.
La physiopathologie n’est pas encore élucidée, mais les travaux réalisés convergent pour indiqués qu’il s’agit d’un trouble en relation avec la plasticité cérébrale. Il existe une plasticité de l’organisation sensori-motrice, la pratique de longue année durant, à un niveau technique élevé, demandant une grande précision du geste sur le plan musculaire, des doigts ou des muscles de l’embouchure entraînerait une désorganisation de cette plasticité en faveur d’une dédiférenciation du zonage de cette organisation sensori-motrice perturbant alors le contrôle du mouvement involontaire. Des prédispositions génétiques pourraient également intervenir.
Le diagnostic est clinique et repose sur l’analyse et l’expérience du clinicien, c’est la raison pour laquelle à la Clinique du musicien nous avons mis en place une Consultation pluridisciplinaire experte dans ce domaine qui permet après un examen minutieux du musicien en dehors de l’instrument et à l’instrument d’établir un diagnostic. De manière parallèle, il est important de faire un diagnostic négatif afin d’éliminer d’autres affections qui pourraient donner des symptômes similaires ou voisins. L’expérience de l’équipe médicale et paramédicale est importante pour établir un diagnostic de dystonie de fonction puisqu’il n’y a pas d’examen objectif de la dystonie de fonction.
Le traitement est complexe et de longue durée. Il demande une grande expérience du kinésithérapeute, il repose globalement sur la re programmation du geste. Le but est développer un nouveau programme sensori-moteur et pour cela plusieurs méthodes peuvent être utilisées.
Docteur A-F ARCIER, fondateur de la Clinique du Musicien® et de la Performance Musicale